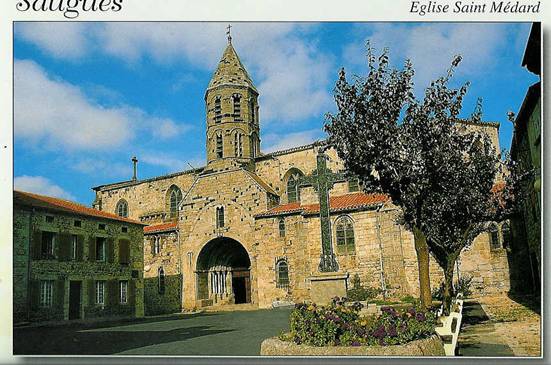XXV . Conciles particuliers . Assemblées épiscopales
Retour au plan : THEOLOGIE DE L'EPISCOPAT
1°) Théologie de la collégialité partielle.
2°) Les conciles régionaux dans l’antiquité.
3°) L’évolution du synode particulier au cours du second millénaire de l’ère chrétienne.
4°) Le statut canonique actuel du concile particulier dans l’Eglise latine.
1°) Théologie de la collégialité partielle.
Dans ses développements doctrinaux le concile Vatican II n’a guère envisagé que la collégialité totale ou universelle des évêques, ou collégialité absolue. Ce qu’il entend par « collège » c’est l’ensemble des évêques du monde entier, réellement ou potentiellement réunis en un seul lieu, avec à leur tête la présidence, personnelle ou déléguée, du souverain pontife.
Mais la collégialité des évêques s’exerce aussi au niveau local, dans des assemblées partielles : qu’elles soient régionales, nationales, continentales voire patriarcales.
La collégialité partielle des évêques existe de fait. Quel est donc son statut théologique ?
En lui-même le concile régional, ou assemblée des évêques d’une même région (dans l’Eglise antique on ne faisait pas la différence), possède une autorité supérieure, doctrinale et disciplinaire, sur toute la région concernée. Une telle autorité supérieure découle directement de l’autorité apostolique dont les évêques sont les héritiers, en corps comme individuellement. Pour autant, une telle autorité locale reste subordonnée, en droit, à l’autorité universelle de l’Eglise, incarnée soit dans l’épiscopat mondial soit dans la seule Eglise romaine. Elle est limitée par ces deux instances. Elle ne peut contrevenir à leur législation, ni la révoquer.
De droit divin, dans les limites que nous venons de poser, le concile régional possède une autorité suprême à l’égard de tout évêque simplement diocésain de son ressort. Il peut le déposer. Il peut réformer ses sentences. Une telle doctrine semblera peut-être hardie. Elle s’impose cependant à l’esprit. C’est bien ainsi que l’entendait l’Eglise ancienne.
Le concile d’Antioche par exemple, réuni en 324, et donc antérieur au concile de Nicée (premier de la liste officielle des œcuméniques), qualifiait le concile provincial, normalement présidé par son métropolite (évêque de la cité la plus importante), de concile parfait : « teleia sunodos ». (Cf. : ‘‘Les Conférences épiscopales’’ par Legrand, Manzanarès, Garcia y Garcia. P. 60-61. Aux éditions du Cerf. 1988.). Parfait non seulement dans sa composition mais par sa compétence canonique ou doctrinale, et son autorité sur toute la province. Tout lui est soumis, et il décide localement en dernière instance. Il n’est soumis lui-même qu’à l’Eglise universelle. On ne voit donc pas d’où il pourrait tirer son emprise, sinon de la puissance apostolique héritée par les évêques réunis en collèges mêmes restreints. Le concile partiel est l’héritier du collège apostolique pour la portion d’Eglise qu’il contrôle. Il se présente comme un fractionnement du collège épiscopal tout entier, et il détient son autorité dans l’Eglise locale concernée.
Le concile oecuménique de Nicée, en 325, confirmait cette autorité du concile particulier. C’est ce dernier qui était chargé (canon 4) d’élire et de consacrer les évêques de la province. Le canon 5 prévoyait formellement que les conciles provinciaux bisannuels pussent casser les sentences d’excommunication des évêques individuels.
La pratique constante de l’Eglise ancienne montre que le concile particulier pouvait déposer les évêques récalcitrants.
En matière de foi, le concile particulier dispose d’une autorité magistérielle, qui est sans appel dans sa province. Toutefois ses décisions ne jouissent pas par elles-mêmes de l’infaillibilité. Elles peuvent être réformées par l’autorité supérieure. Elles restent soumises au jugement de l’Eglise universelle, et de l’Eglise romaine.
Il est arrivé pourtant que des sentences d’un concile particulier entrassent dans le kérygme, et valussent comme dogmes de la foi pour l’Eglise universelle et pour tous les temps. Mais c’est qu’elles ont été expressément ou tacitement acceptées par l’épiscopat universel, ou bien qu’elles ont été confirmées par l’Eglise romaine. On peut citer comme exemples : le second concile d’Orange en 529, confirmé en 531 par le pape Boniface II ; le 16e concile de Carthage de 418 ; le 11e concile de Tolède tenu en 675 ...
Les papes eux-mêmes ont pu porter des sentences dogmatiques destinées à l’ensemble de l’Eglise au sein de conciles particuliers : cela s’est vu pour Damase au concile de Rome en 382 ; pour le pape Martin Ier au concile de Latran de 649 etc...
Dans le concile particulier, ou régional, s’exerce donc une autorité authentique et de droit divin, mais limitée – également de droit divin – par le droit universel de l’Eglise. Le concile particulier met en œuvre partiellement la collégialité apostolique. Il est la plus haute instance locale, mais il demeure subordonné à l’Eglise catholique comme telle, et au pontife romain. C’est pourquoi sa pratique a pu évoluer si considérablement au cours de l’histoire.
2°) Les conciles régionaux dans l’antiquité.
Dès la haute antiquité chrétienne, l’Eglise ancienne, alors que n’existait pas encore l’institution patriarcale, que la tenue des conciles œcuméniques était impossible, et que le siège de Rome était souvent beaucoup trop éloigné, s’est autogouvernée par des conciles particuliers. On peut dire que le concile particulier procède de la nature même de la constitution divine de l’Eglise, puisqu’il faut déjà un mini-concile pour élire, pour consacrer et pour installer un nouvel évêque. Si l’épiscopat a donc ainsi une origine nécessairement collégiale, il retrouve spontanément un fonctionnement collégial dès que surgissent des différends, des causes majeures, des questions intéressants l’ensemble des Eglises, ou même un grave désordre dans une seule Eglise particulière et qui ne peut être réglé qu’à l’échelon supérieur.
Les premiers conciles particuliers dont l’histoire fasse mention furent réunis en Asie mineure à propos de la crise montaniste, vers la fin du second siècle. Il y eut ensuite ceux provoqués par le pape Victor Ier au sujet de la fixation de la date de Pâques.
Les évêques agirent collégialement, dès le principe, par les relations qu’ils établirent entre eux et ne cessèrent d’entretenir : par leurs échanges épistolaires, par leurs visites. Mais leur réunion physique en un seul lieu s’imposait dès que surgissait une crise plus grave, comme il en fut pour les apôtres, au moment du concile de Jérusalem. Dès que rassemblés, les évêques parlaient au nom du Saint-Esprit, en vertu de la prévalence tacitement reconnue du collège sur l’évêque individuel. Ils parlaient au nom du Saint-Esprit comme l’avait déjà fait le concile de Jérusalem, et c’est de cette présence toujours agissante de l’Esprit que le concile tirait son autorité. Car l’Esprit est un principe d’unité, d’unanimité, de consensus, et non de discorde. De plus, une foi commune et identiquement proclamée était nécessaire à la vie et même à la survie de la jeune Eglise.
Si l’on garde moins trace de synodes tenus à dates régulières en Orient, dès les premiers siècles on voit s’instaurer des conciles périodiques dans les Eglises d’Italie, d’Afrique et d’Espagne. Comme on le sait, c’est le concile de Nicée qui édicterait leur tenue obligatoire et leur fréquence bisannuelle. Mais il ne les a certainement pas créés. Il n’a fait que légiférer en ce domaine essentiel de la vie publique de l’Eglise.
Pendant le Ier millénaire, le concile régional (ou particulier), parfois transformé en concile général (ou œcuménique), fut un organe normal du gouvernement de l’Eglise. Pour éviter l’anarchie, les papes de Rome ont toujours cherché à contrôler ces conciles, à les superviser, sans y parvenir totalement. En tous les cas Rome a toujours maintenu le principe qu’aucun concile, général ou particulier, ne pût avoir une valeur universelle sans son accord.
3°) L’évolution du synode particulier au cours du second millénaire de l’ère chrétienne.
Nous avons vu au chapitre précédent que, durant le second millénaire, les papes de Rome parvinrent à maîtriser à peu près complètement le concile universel qui ne se réunissait plus qu’à leur initiative et qui était devenu exclusivement de droit pontifical. Il y eut des exceptions, bien sûr, quand le concile se révoltait contre eux, comme il en fut par exemple du concile schismatique de Bâle (1431-1449). Mais ces exceptions ne firent que confirmer la règle.
Depuis la réforme grégorienne du XIe siècle, les papes ont tenté aussi de prendre le contrôle des conciles particuliers, du moins en Occident. Ils l’ont fait surtout en les faisant présider par leurs légats, et en les soumettant à une législation plus stricte. Le concile de Trente imposait la révision des actes des conciles particuliers par le Saint-Siège. Tandis qu’en Orient les conciles particuliers se transformaient en synodes patriarcaux.
Les conciles particuliers ont toujours été maintenus, en droit, dans l’Eglise latine, y compris par les codes de droit canonique édictés en 1917 puis 1983. Mais devant la législation de plus en plus contraignante qui les enserre, ils tendent à tomber en désuétude. Ils sont devenus des instances inadaptées pour le gouvernement de l’Eglise locale. Ils se voient remplacés progressivement par d’autres formes d’exercice de la collégialité : les assemblées nationales d’évêques qu’on rencontre dès le moyen âge ; les conférences épiscopales qui apparaissent timidement au XIXe siècle, mais qui ne seront normalisées et généralisées qu’à partir du second concile du Vatican.
4°) Le statut canonique actuel du concile particulier dans l’Eglise latine.
Le concile particulier est régi par les canons 439 à 446 du nouveau code de droit canonique. Sont formellement distingués le concile plénier qui réunit les évêques de toute une nation, et le concile provincial qui réunit les évêques d’une seule province. Le concile plénier est convoqué à la demande de la conférence épiscopale, et présidé par l’évêque désigné par elle. Le concile provincial est convoqué à la demande des évêques de la province. Il est présidé par le métropolitain ou archevêque. Il est reconnu au concile particulier, qu’il soit plénier ou provincial, un plein pouvoir de gouvernement ecclésiastique sur le territoire concerné. Mais ses actes ne peuvent prendre vigueur qu’avec l’approbation du Saint-Siège.
La tradition du concile particulier est donc maintenue pieusement dans le code. Mais en fait, cette procédure n’est pratiquement plus utilisée. La collégialité épiscopale s’exprime désormais sous une forme moderne, appelée la Conférence épiscopale. Le concile Vatican II l’a officialisée, et le nouveau code lui reconnaît une pleine personnalité juridique.
5°) La conférence épiscopale.
Précédées au moyen âge, et à l’époque classique, par les assemblées épiscopales, qui se réunissaient en dehors des formes et des normes conciliaires, les conférences épiscopales firent une apparition sporadique à partir du XIXe siècle. Le concile Vatican II les a étendues à l’ensemble de l’Eglise latine : « Les conférences épiscopales, établies déjà dans plusieurs nations, ont donné des preuves remarquables de fécondité apostolique ; aussi le Concile estime-t-il tout à fait opportun qu’en tous lieux les évêques d’une même nation ou d’une même région constituent une seule assemblée et qu’ils se réunissent à dates fixes pour mettre en commun les lumières de leur prudente expérience. » (Décret Christus Dominus, 37). La Constitution dogmatique sur l’Eglise, Lumen Gentium, reconnaît que les « Conférences épiscopales peuvent, aujourd’hui, contribuer de façons multiples et fécondes à ce que le sentiment (affectus) collégial se réalise concrètement. » (L.G. 23).
Les décisions des conférences épiscopales n’obligent juridiquement que dans les cas prévus par le droit commun, ou concédés explicitement par le Saint-Siège. Même dans ces hypothèses, les décrets doivent être pris à la majorité des deux tiers des membres de la conférence, et ensuite approuvés par le Saint-Siège. (Christus Dominus, 38, n°4, repris par le nouveau code de droit canonique)
Cependant lesdites conférences exercent une autorité morale et magistérielle bien au-delà de ces dispositions canoniques (un peu restrictives), par leurs déclarations et leurs prises de position. Elles font désormais partie intégrante de la vie et de l’histoire des Eglises nationales, ou territoriales. On peut même dire qu’elles sont devenues le visage de ces Eglises nationales, ou territoriales. Elles sont complétées par les conférences continentales comme le C.C.E.E. (conseil des conférences des Eglises d’Europe) ou le C.E.L.A.M. (conférence des Eglises d’Amérique latine).
Comme les conciles particuliers, dont elles représentent une autre forme, une forme dérivée, les conférences épiscopales possèdent un fondement théologique incontestable ; elles s’enracinent dans le droit divin de l’Eglise. Comme le concile particulier, elles mettent en œuvre et permettent l’application de ce que nous avons appelé la collégialité partielle. Dans leur principe, elles sont donc de droit divin ; mais seulement de droit ecclésiastique dans les modalités pratiques de leur exercice, qui les encadrent.
Elles incarnent la collégialité partielle : celle des évêques d’un territoire donné. Et pourtant, en un autre sens, elles représentent aussi l’ensemble de l’épiscopat. De même que tout évêque représente déjà, à lui tout seul, le corps épiscopal, elles sont le collège épiscopal, ou mieux encore le collège apostolique, en tant que présents sur un territoire donné. Et elles agissent en leur nom et avec leur autorité ; mais, encore une fois, selon les modalités édictées par les autorités supérieures, et non pas contre elles ; avec la compétence précise, ni plus ni moins, que leur reconnaissent ces autorités supérieures.
De droit divin dans leur principe, elles n’en sont pas moins régies par le droit ecclésiastique et, subsidiairement, soumises à la modération pontificale.
Sous une forme ou sous une autre, en effet, les conférences épiscopales ont toujours existé dans l’Eglise et elles existeront toujours. On ne peut empêcher les évêques d’une même contrée de « conférer » entre eux et de prendre en commun les décisions d’ordre pastoral (doctrinales ou disciplinaires) qui s’imposent à l’intention de leurs diocésains respectifs.
Le fondement théologique ultime de la conférence épiscopale réside ainsi dans le collège apostolique. Il remonte au jour de la Pentecôte. Il remonte même à quelques jours avant. En effet les apôtres, réunis à Jérusalem, attendant puis recevant, puis ayant reçu le Saint-Esprit, représentaient par anticipation tous les « évêques » et tous les « prêtres » du futur : ils cooptaient l’un d’entre eux (dès avant la Pentecôte) ; ils conféraient dans l’Esprit Saint ; ils prenaient telles orientations missionnaires ; ils imposaient les mains aux diacres et aux prêtres.
L’Esprit Saint ne laisse pas de présider tous les conciles, même les plus restreints, pourvu qu’ils demeurent dans l’unité chrétienne, pourvu qu’ils gardent l’obédience de la foi. Le collège épiscopal commence là où deux évêques seulement sont réunis es qualités.
La réunion des évêques d’une même province fait figure de « présence réelle » de l’épiscopat universel, à la condition, bien entendu, de ne pas se rebeller contre lui ! Car l’épiscopat est un ministère d’unité et donc de charité. Unité maintenue dans la monarchie ; charité exercée dans la collégialité.
Le concile ou synode particulier, ou en leur lieu et place la conférence épiscopale, forment dans l’Eglise une instance intermédiaire, à mi-chemin de l’autorité universelle, ou papale, et de l’Eglise diocésaine. Les trois instances, universelle, synodale et diocésaine sont toutes les trois de droit divin, mais selon des modalités, ou des spécificités très distinctes.
6°) Remarque en forme d’incise : comment fonctionne le « principe de subsidiarité » dans l’Eglise de Dieu.
Le principe de subsidiarité fait partie intégrante de la doctrine sociale de l’Eglise.
Il a été énoncé explicitement, pour la première fois, dans l’encyclique Quadragesimo anno (1931) de Pie XI. Il sert à définir les rapports qui doivent s’établir, dans la société civile, entre les différents niveaux d’autorité. Selon la doctrine de l’Eglise, priorité doit toujours être laissée à la personne humaine, d’une part, et d’autre part aux institutions de rang inférieur, à commencer par la famille. Les collectivités plus larges se voient seulement assigner un rôle « subsidiaire » de suppléance. L’organisme supérieur assume, et prend en charge, seulement ce que l’organisme inférieur ne peut pas porter.
On pourrait se demander légitimement si ce principe s’applique dans la société religieuse qu’est l’Eglise. Les papes Pie XII et Paul VI ont parfaitement admis que le principe de subsidiarité jouât dans l’Eglise, mais avec une restriction : « sans préjudice de son organisation hiérarchique. » (Pie XII, Allocution au Consistoire, 20 février 1946).
Le principe de subsidiarité, s’il est pertinent pour décrire la vie de l’Eglise en tant que corps social, n’y fonctionne cependant pas de la même manière que dans la société civile. En fait, il y fonctionne à l’envers.
Dans la société civile, répétons-le, les cellules les plus englobantes, comme l’Organisation des Nations Unies, les fédérations continentales, les Etats, sont ou devraient rester subsidiaires par rapport aux cellules plus petites, comme la région, la commune, l’entreprise, la famille. Et tout devrait se subordonner aux droits de la personne humaine, qui demeure la réalité fondamentale de l’ordre social. Dans l’Eglise, c’est tout juste le contraire. Même la personne humaine du fidèle y est au service de la Personne divine du Christ. Les cellules infra-diocésaines de droit ecclésiastique, telle que la paroisse, la communauté de base, le monastère, sont subsidiaires par rapport à l’Eglise particulière, ou diocèse, ou éparchie, qui, elle, est de droit divin. Quant au diocèse, il est subsidiaire par rapport à l’Eglise patriarcale, ou nationale, ou continentale, à laquelle il est soumis. De même toutes les Eglises patriarcales, nationales ou continentales sont subsidiaires par rapport à l’unique Eglise « catholique » fondée par Jésus-Christ, dont elles sont en quelque sorte des répliques. Certes, comme l’enseigne Vatican II, l’Eglise particulière possède en elle-même toute la réalité de l’Eglise universelle, qui est sa source, (cf. L.G. 23) mais à la condition expresse de lui rester fidèle, de même que les cellules d’un corps vivant restent solidaires de l’organisme entier et participent de son métabolisme. Dans l’Eglise « catholique », c’est l’universel qui est premier, parce qu’il provient lui-même d’en haut, comme une grâce qui est donnée. Le particulier participe à la dignité de l’universel, tandis que l’universel se réalise et s’épanouit dans le particulier.
L’Eglise simplement diocésaine, bien que de droit divin, n’en est pas moins subsidiaire par rapport à l’Eglise provinciale ou métropolitaine, car elle a été fondée après elle et bien souvent par elle. Les premiers évêques furent d’abord des missionnaires venus de Jérusalem, ou d’Antioche, ou d’Alexandrie, ou de Rome... dans telle province pour y implanter la foi. Ce n’est qu’ensuite qu’ils devinrent des évêques résidentiels. Aujourd’hui encore, dans une Eglise particulière, l’évêque vient d’ailleurs. Ou tout au moins il a été ordonné par des évêques venus d’ailleurs et que représentaient l’ensemble de l’Eglise. L’autorité hiérarchique descend plus qu’elle ne monte. Elle procède d’en haut ; puis se répand vers le bas. Le hiérarque, qui ne s’est pas nommé lui-même, mais qui a reçu de l’Eglise à la fois son titre, son sacerdoce et sa mission pastorale, agit « in personna Christi », à la place du Christ.
Que le principe de subsidiarité doive se lire à l’envers dans l’Eglise n’implique nullement que les réalités inférieures de cette même Eglise : la personne humaine, les cellules primaires du tissu ecclésial, soient dévalorisées. On ne peut le croire ni le craindre. Bien au contraire on peut pressentir que la personne humaine et, après elle, les communautés les plus humbles comme la famille, l’équipe de base, la paroisse, bien que subsidiaires dans le corps mystique du Christ, deviennent (dans cette philosophie) les priorités ou les finalités véritables de l’institution Eglise. L’Eglise vient au secours de l’homme pour le sauver, après avoir été elle-même sauvée par son Seigneur. On a là un type de subsidiarité illustré par la parabole du Bon Samaritain. C’est le supérieur, c’est Dieu lui-même qui se met au service du plus chétif, du plus « secondaire », du plus « subsidiaire » : « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir... » (Mt 20,28).
7°) Les congrès d’Eglises.
La collégialité fondamentale du corps ecclésial, qui n’est pas seulement celle de l’épiscopat, pourrait s’exprimer dans des rencontres élargies, des congrès, auxquels participassent non seulement les évêques mais encore les délégués, élus ou nommés, des différentes communautés, ou encore le peuple fidèle. Certes toute eucharistie, ou même toute célébration liturgique, sont déjà par elles-mêmes des congrès d’Eglises, dans lesquels le Christ est présent selon sa promesse.
Il existe déjà, on le sait, les congrès eucharistiques qui peuvent rassembler des foules très nombreuses. On a entendu parler d’assemblées internationales dans divers mouvements d’Eglise, ou même dans d’autres confessions chrétiennes. Les foules immenses réunies par Jean-Paul II, lors de ses voyages planétaires, participent également de cette réalité de congrès. Ce ne sont pas encore, cependant, des conciles œcuméniques, ni même des congrès universels. Ces divers rassemblements émargent plutôt, théologiquement, à cette collégialité partielle dont nous avons traité.
Au niveau européen, on a remarqué, dans un passé récent, deux congrès (celui de Bâle, en 1989, celui de Graz, en 1997) qui ont concentré des chrétiens de toutes confessions, naguère séparés par le rideau de fer. S’y opérèrent des retrouvailles encore timides, mais fécondes. Ces congrès semblent présager d’autres rencontres encore plus vastes. C’est ainsi que se reconstitue peu à peu sous nos yeux l’unité perdue.