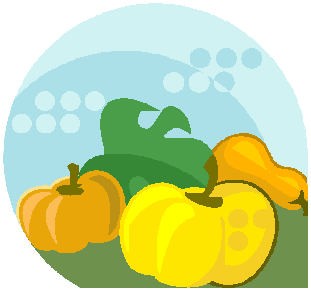VII . 2 . L’ordination épiscopale
Retour au plan : THEOLOGIE DE L'EPISCOPAT
D’un point de vue sacramentel donc, mais non pas d’un point de vue juridictionnel, l’essentiel de la succession apostolique se transmet par l’ordination épiscopale.
« La consécration épiscopale [enseigne le concile Vatican II], en même temps que la charge de sanctifier, confère aussi des charges d’enseigner et de gouverner, lesquelles cependant, de part leur nature, ne peuvent s’exercer que dans la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres. » (Lumen Gentium, 21).
Le concile a bien conscience que par l’ordination épiscopale est transmis l’essentiel du pouvoir sacerdotal (la charge de sanctifier). Quant à l’exercice du pouvoir pastoral (la charge d’enseigner et de gouverner), il reste soumis au droit ecclésiastique en vigueur ; il reste subordonné en toute hypothèse, au moins dans l’Eglise catholique romaine, au pontife romain.
L’ordination épiscopale transmet le pouvoir sacerdotal d’une manière absolue et définitive, en imprimant dans l’âme de celui qui le reçoit un caractère qui sera éternel : Sacerdos in aeternum.
Quant au pouvoir pastoral, il n’est transmis que d’une manière relative, subordonnée au droit commun ecclésial. Son exercice, c’est-à-dire en fait la juridiction, n’est transmis que par l’élection légitime suivie de la prise de fonctions ou intronisation. Pour le dire en bref, l’élection donne le droit aussi bien au pouvoir sacerdotal qu’au pouvoir pastoral. La consécration accorde le pouvoir sacerdotal avec certainement le charisme surnaturel, et général, du pouvoir pastoral. Mais la prise de fonctions, elle seule, met en possession effective de ce pouvoir pastoral sur telle ou telle Eglise.
La preuve que la consécration épiscopale ne confère pas par elle-même la juridiction sur telle Eglise déterminée, c’est que cette juridiction peut changer ou se modifier. (Un évêque ordonné pour tel siège qui, plus tard, sera transféré à un autre siège ; un autre qui verra sa juridiction restreinte, ou au contraire augmentée. Ils ne seront pas pour autant réordonnés, car la consécration est acquise une fois pour toutes. La consécration est une, et la même pour tous les évêques ; tandis que la juridiction est très diverse, selon les cas. Un évêque parti en retraite, un évêque déposé, sont désormais privés de toute juridiction. Ils n’en demeurent pas moins évêques).
Nous avons déjà considéré (au chapitre IV) la nature des pouvoirs sacerdotaux de l’évêque, ainsi que (au chapitre V) les différents aspects de son pouvoir pastoral. Tous ces pouvoirs lui sont transmis par l’ordination, les premiers dans toute leur étendue, les seconds seulement dans leur principe et quant au charisme surnaturel.
Il nous reste à examiner maintenant les modalités, qui sont elles aussi de droit divin, de l’ordination épiscopale proprement dite, dans ses fastes liturgiques qui sont hérités, eux aussi dans leur principe, des apôtres.
Elle s’accomplit essentiellement par l’imposition des mains des successeurs des apôtres, eux-mêmes validement ordonnés, sur l’ordinand. Imposition des mains accompagnée d’une prière, qu’on appelle la prière consécratoire, et qui définit sans ambiguïté l’ordre ici conféré.
Il faut bien comprendre la signification de ce geste : il est à la fois charismatique et liturgique, mais aussi en quelque façon juridique. Il est un geste traditionnel, hérité des apôtres, par lequel se transmet l’Esprit Saint, l’Esprit de Pentecôte, en même temps que la charge afférente à l’ordre considéré.
Nous pénétrons bien, ici, dans le cœur de notre propos théologique.
Le fonctionnement interne de l’ordination épiscopale, et son économie pourrait-on dire, obéissent à trois principes, indépendants l’un de l’autre d’une part, mais d’autre part providentiellement coordonnés l’un à l’autre, et tous les trois de droit divin, même s’ils ne sont pas explicitement définis comme tels par le magistère.
Principe I. De droit divin, les évêques ordonnés seuls ont le pouvoir de transmettre validement l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat. C’est ce que nous pensons avoir établi dans le chapitre IV de ce travail, en analysant les pouvoirs sacerdotaux spécifiques de l’évêque.
Principe II. De droit divin l’ordre épiscopal est normalement conféré par un collège d’évêques, eux-mêmes validement ordonnés (au moins au nombre de trois depuis le concile de Nicée en 325 : canon 4). Ce collège représente, bien entendu, tout le collège épiscopal qui est répandu dans le monde entier.
Principe III. Egalement de droit divin, l’imposition des mains par un seul évêque, lui-même validement ordonné, suffit à la validité de ce sacrement, à supposer même que cet évêque ne fût pas le consécrateur principal, qu’il ne fût pas le président de la cérémonie d’ordination ; s’il n’est qu’un évêque assistant.
Que ces trois principes fussent de droit divin, cela se déduit de la pratique constante de l’Eglise, de sa pratique universelle. Cependant, répétons-le, ils n’ont jamais fait l’objet d’une définition formelle du magistère. On pourrait même soutenir la thèse que le concile Vatican II, qui se voulait avant tout pastoral, et non pas dogmatique, a délibérément évité de se prononcer sur eux.
Il s’est contenté d’enseigner la sacramentalité de l’épiscopat (Cf. Lumen Gentium, 21) comme nous l’avons déjà dit. Mais si l’épiscopat est sacramentel, il faut bien qu’il soit une fonction propre et même exclusive dans l’Eglise. Sinon il ne servirait à rien. Si le prêtre pouvait, même à titre exceptionnel, ordonner d’autres prêtres, l’épiscopat serait inutile. On pourrait se passer de lui. Ce degré suprême du sacrement de l’ordre eût pu se perdre, sans inconvénient grave pour la vie de l’Eglise.
Le principe I peut donc se déduire logiquement de la sacramentalité de l’épiscopat.
Quant aux principes II et III, par leur combinaison harmonieuse et vraiment providentielle, vraiment d’institution divine (quoique non définie comme telle), ils assurent la pérennité de l’épiscopat à travers les âges, la survie de la succession apostolique. Et voici comment.
Supposons en effet que le principe II (ordination normale de l’évêque par un collège) n’existât pas : l’épiscopat dans l’Eglise se verrait alors normalement et habituellement transmis par l’imposition des mains d’un seul évêque, et cela depuis l’origine. Il suffirait qu’à une époque quelconque de l’histoire, et Dieu sait si l’Eglise a traversé des périodes troublées, la succession apostolique eût été interrompue pour une raison quelconque : volontaire ou accidentelle, consciente ou inconsciente, connue ou inconnue, dans chacune des lignées épiscopales jusqu’à nous, pour que la suite des évêques dans ces lignées fût frappée d’invalidité, et ceci jusqu’à la fin du monde.
Tout évêque aujourd’hui pourrait douter à bon droit de la valeur du sacerdoce qu’il a reçu. Et les fidèles répandus sur toute la terre pourraient douter de la validité de leurs prêtres et de la validité des sacrements à eux administrés par leurs prêtres ! (à l’exception toutefois du baptême et du mariage).
Bien sûr, certains théologiens feraient appel ici à la notion de « suppléance ». L’Esprit Saint, dirait-on, pourrait suppléer à la défaillance des ministres et assurer la succession apostolique malgré les avatars possibles de l’histoire. Il pourrait garantir cette succession d’une façon quasi miraculeuse.
On peut espérer en effet que Dieu dans sa miséricorde exerce effectivement cette « suppléance » dans tous les cas de vices cachés des sacrements, surtout au bénéfice des fidèles. Mais, théologiquement ou canoniquement, on ne peut faire fond sur cette notion de suppléance, qui reste trop incertaine. En cas de doute réel, positif, sur la validité d’un ordre, l’Eglise s’est toujours montrée « tutioriste » par motif de conscience, et on la comprend. Par précaution elle a toujours demandé la réitération des ordres douteux. (Elle le fait encore, par exemple, à l’égard des prêtres anglicans qui se convertissent au catholicisme, parce qu’elle doute de la validité de l’ordre qu’ils ont reçu dans leur Eglise d’origine).
Il est donc heureux que par une disposition que l’on peut qualifier de providentielle, l’épiscopat ait toujours été normalement transmis par un collège d’évêques, de telle sorte que le risque de nullité fût pratiquement et statistiquement écarté, le doute anéanti.
Toutefois un seul évêque suffit, à la rigueur, pour consacrer validement un autre évêque : c’est le principe III. Un seul évêque représente à lui seul tout le collège épiscopal. Il est à lui seul le successeur des apôtres et le détenteur de la plénitude du sacerdoce. Ce principe III vient encore renforcer l’efficacité du principe II. Si, par impossible, au sein du collège des évêques ordinants, un seul était véritablement évêque, ou encore un seul avait vraiment l’intention requise pour ordonner selon la foi de l’Eglise, même dans le cas où cet évêque ne serait pas le consécrateur principal, l’ordination serait valide et la succession apostolique assurée.
Il est notoire qu’en cas de nécessité l’Eglise se contente d’appliquer le principe III, malgré la prescription du concile de Nicée. Récemment, les ordinations clandestines, par-delà le rideau de fer, furent plusieurs fois célébrées par un seul évêque, avec l’assentiment du Saint-Siège. Saint Grégoire le Grand mandait à saint Augustin de Cantorbéry, qui sollicitait ses instructions : « Est-il possible que l’évêque de Cantorbéry, seul évêque pour le moment dans le pays, procède à des sacres d’évêques sans aller chercher très loin des prélats assistants ? Provisoirement, oui, répond le pape, mais qu’il ordonne au plus tôt dans son voisinage les assistants demandés par les canons. » (Fliche et Martin, tome 5, page 286). On discerne ici clairement affirmés les principes II et III, et même sous-entendu le principe I.
C’est donc grâce aux principes susdits que la succession apostolique s’est maintenue jusqu’à nous, et qu’elle se maintiendra jusqu’à la fin des temps, avec une surabondance de sécurité.
Quelques conditions sont requises de la part de l’impétrant pour qu’il reçoive validement l’épiscopat. Il faut d’abord, comme pour le presbytérat et le diaconat, qu’il soit du sexe masculin. Le nouveau Catéchisme de l’Eglise catholique expose de manière exhaustive la doctrine romaine, qui est celle aussi de toutes les Eglises de forme traditionnelle et ancienne : « Seul un homme (vir) baptisé reçoit validement l’ordination sacré. Le Seigneur Jésus a choisi des hommes (viri) pour former le collège des douze apôtres, et les apôtres ont fait de même lorsqu’ils ont choisi les collaborateurs qui leur succéderaient dans leur tâche. Le collège des évêques, avec qui les prêtres sont unis dans le sacerdoce, rend présent et actualise jusqu’au retour du Christ le collège des douze. L’Eglise se reconnaît liée par ce choix du Seigneur lui-même. C’est pourquoi l’ordination des femmes n’est pas possible. » (N° 1577). C’est la pratique constante de toutes les Eglises dont l’origine remonte aux apôtres.
Du point de vue sacramentel, il faut encore que le candidat à l’épiscopat soit baptisé. Même s’il n’a reçu au préalable aucun ordre intermédiaire (le sachant ou l’ignorant, ses consécrateurs le sachant ou l’ignorant), même si, par exemple, il n’est pas confirmé, il reçoit validement l’épiscopat et avec lui la plénitude du sacrement de l’ordre. Car le baptême est la condition nécessaire, mais suffisante, pour accéder à tous les ordres, pour accéder à tous les sacrements. Le baptême étant la porte d’entrée dans l’Eglise, et aussi vers tous les autres sacrements. On sait que dans l’Eglise ancienne on pratiquait volontiers les ordinations « per saltum ». Les diacres élus à l’épiscopat, par exemple un saint Léon le Grand élu pape en 440, étaient directement consacrés évêques, sans être au préalable ordonnés prêtres. Mais ils recevaient, par cette imposition des mains, la plénitude du sacrement de l’ordre.
Il faut encore que le sujet ait l’intention de recevoir l’épiscopat, ou tout au moins qu’il n’y oppose pas de volonté contraire. Un enfant, ou un adolescent, ordonné évêque le serait validement. Le cas s’est produit plus d’une fois dans l’histoire, soit dans l’Eglise catholique, soit en dehors de ses frontières. Citons le pape Benoît IX élu et consacré évêque de Rome, en 1032, à l’âge de douze ans. Il est par ailleurs compté trois fois dans la liste officielle des papes. (Vérifiez !). Citons encore le catholicos et patriarche de l’Eglise chaldéenne d’Irak : Mar Eshai Shimoun XXIII, sacré en 1920 à l’âge de onze ans. Cet homme, destitué dès 1933, exilé plus tard aux Etats-Unis, devait périr assassiné en 1975.
Les conditions d’accès à l’épiscopat que nous venons de passer en revue sont donc minimales. Elles facilitent une transmission régulière de la charge apostolique. Le seul risque important d’invalidité, qui pourrait subsister, résiderait dans le non-baptême éventuel d’un candidat. Cela rendrait nuls tous les sacrements qu’il recevrait, ou tous ceux que plus tard il administrerait lui-même, mis à part et c’est important les baptêmes et les mariages. On pourrait alors espérer cette « suppléance » divine, dont nous parlions plus haut, pour réparer les dégâts causés par ce vice caché, surtout au bénéfice des fidèles, éventuellement lésés. Mais en toute hypothèse la présence d’un faux évêque, par exemple un non-baptisé, au sein d’un collège d’ordinants, n’entraînerait pas l’invalidité de l’ordination épiscopale, étant donnée justement sa nature collégiale.
Quant au geste même de l’imposition des mains, accompagné d’une prière, qui constitue le rite essentiel de l’ordination dans tout le monde chrétien, il semble avoir été inventé par les apôtres juste après la Pentecôte. Il symbolise l’effusion ou la transmission de l’Esprit. Tandis que la prière consécratoire non seulement désigne mais décrit la charge qui est attribuée par le rite.
On sait que les théologiens scholastiques du Moyen Age, imités d’ailleurs par les conciles, dont le concile de Trente, désignaient par les catégories aristotéliciennes de « matière » et de « forme » ce geste et cette parole. Le geste pouvait être assimilé à la matière du sacrement, tandis que la parole représentait sa forme, ou son sens, ou sa signification.
Le geste de l’imposition des mains ne semble pas avoir eu de précédent dans le monde sémitique, et les Juifs eux-mêmes ne pratiquaient pas d’ordination au temps des apôtres. On rencontre bien dans la Bible un exemple de transmission du pouvoir par un rite d’imposition des mains, puisque c’est par ce geste que Moïse a institué Josué comme son successeur (Cf. Nb 27,18-23 ; Dt 34,9). Mais un tel type d’investiture ne semble pas avoir été repris dans la suite de l’Histoire Sainte ni dans le domaine religieux ni dans le domaine civil. Personne ne l’a imité.
Le Christ non plus n’a pas employé ce geste pour transmettre l’Esprit Saint, au cours de sa vie terrestre. « Il n’y avait pas encore d’Esprit [note saint Jean], parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié. » (Jn 7,39). L’Esprit Saint était seulement descendu sur Jésus lui-même, au moment du baptême dans le Jourdain, mais il n’était pas encore donné à l’Eglise. (Cf. Mt 3,16 et parallèles).
Certes on a vu le Christ imposer les mains. Mais dans Mt 19,15 cela semble plutôt un simple geste de bénédiction des enfants. Ailleurs, il est vrai, le Christ semblait guérir par le geste, habituel chez lui, de l’imposition des mains : cf. Mt 9,18 ; Mc 5,23 ; 6,5 ; 7,32 ; 8,23-25 ; Lc 4,40 ; 13,13. Il demandait même à ses disciples de l’imiter : cf. Mc 16,18. Mais on ne voit là aucun rapport avec un rite d’ordination.
A la Sainte Cène le Christ a ordonné prêtres du Nouveau Testament ses apôtres, selon la doctrine du concile de Trente, mais sans employer de façon significative le geste de l’imposition des mains
Et le jour même de sa résurrection, le Christ a transmis l’Esprit Saint à ses apôtres, avec le pouvoir d’absoudre les péchés, en soufflant sur eux, sans imposer les mains là non plus. (Cf. Jn 20,22-23).
Il était réservé aux apôtres d’attribuer à ce geste un sens général de don de l’Esprit : soit pour revêtir les nouveaux baptisés de la force d’en haut et des dons charismatiques (cf. Ac 8,16-19 ; 19,5-6), ce qui correspond à notre sacrement de la confirmation (ou chrismation), soit pour investir les nouveaux ministres d’une charge particulière dans l’Eglise (cf. Ac 6,6 ; 13,3 ; 1 Tm 4,14 ; 5,22 ; 2 Tm 1,6 ; He 6,2), ce qui correspond à notre sacrement de l’ordre. Il appartient aux paroles qui accompagnent le geste, la « forme » donc, de préciser sa signification.
La tradition constante (dans le temps), et universelle (dans l’espace), qui s’est perpétuée dans l’Eglise vient corroborer tous ces témoignages scripturaires.